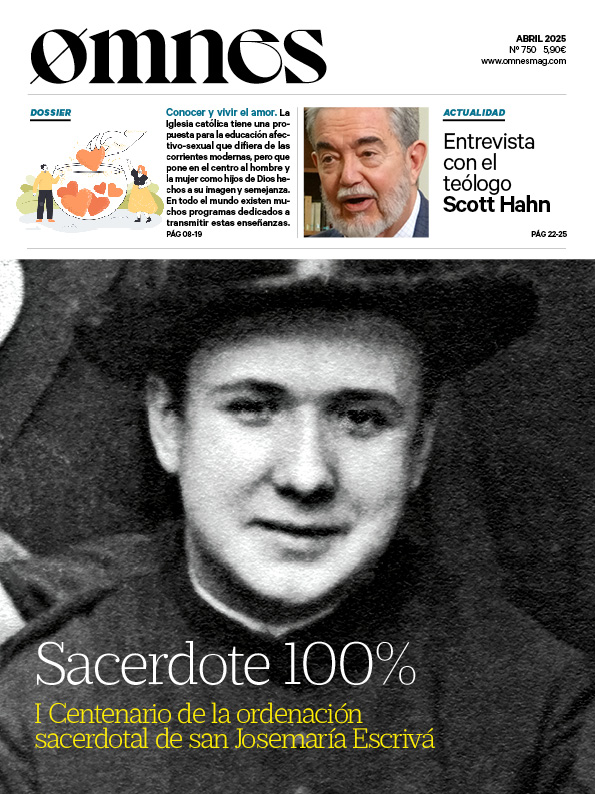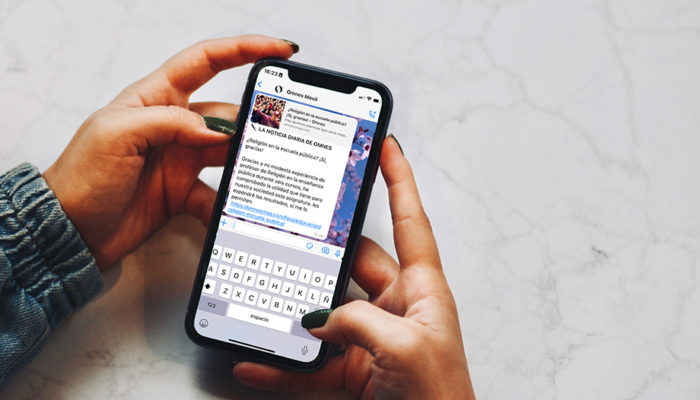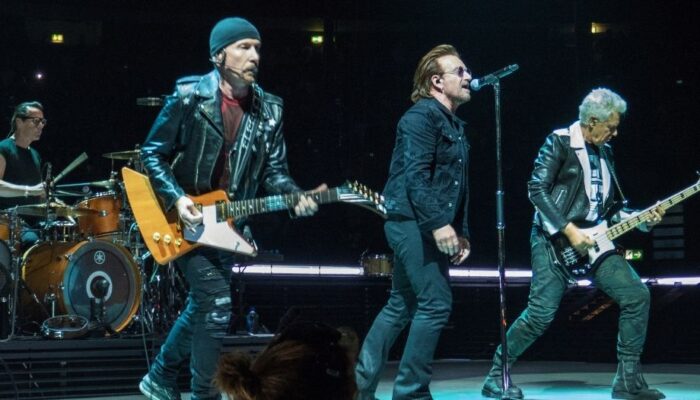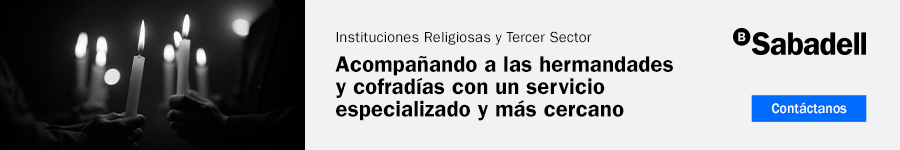Les démonsde F.M. Dostoïevski. Un voyage dans la "solidarité" morale
Les démonsde F.M. Dostoïevski. Un voyage dans la "solidarité" morale Barefoot", le film de Hakuna sur la force vitale de la musique
Barefoot", le film de Hakuna sur la force vitale de la musique "Le pape rappelle à l'Angélus qu'il n'y a pas de dialogue avec le diable
"Le pape rappelle à l'Angélus qu'il n'y a pas de dialogue avec le diableLe film Nefarius (2023), réalisé par les cinéastes américains Chuck Konzelman et Cary Solomon, présente avec un réalisme remarquable une conversation intense entre un condamné à mort possédé par un démon cruel et intelligent et le psychiatre chargé de l'évaluer en prison. La tension narrative repose presque exclusivement sur le dialogue entre les deux personnages, ce qui crée une atmosphère troublante et profondément réflexive.
Le film est conçu d'un point de vue œcuménique, c'est-à-dire qu'il évite explicitement toute référence particulière au catholicisme, comme l'intercession de la Vierge Marie, les saints, les sacrements ou le sacerdoce ministériel. Cependant, le cœur du message est profondément spirituel et tourne autour de la confiance absolue en Dieu, dont l'action salvatrice est centrale. C'est ce qu'indique l'enseignement même de Jésus-Christ dans le Notre Père : "Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal" (Mt 6,13).
La dureté de l'histoire, parfois difficile à supporter, semble également viser à susciter une réflexion sérieuse sur l'abolition de la peine de mort. En ce sens, le film peut être lu comme un plaidoyer en faveur de la vie, dans la lignée de la modification du Catéchisme de l'Église catholique promue par le pape François.
Un débat moderne sur le mal
La caractérisation des personnages et le rythme des séquences captent immédiatement l'attention du spectateur, qui est plongé dans un véritable débat sur le bien et le mal dans le monde contemporain. Le film démasque les arguments de la post-modernité et confronte le spectateur à une réalité spirituelle souvent ignorée ou ridiculisée.
Dans ce cadre, un grand paradoxe émerge : le démon, Nefarius, travaille depuis l'enfance du psychiatre à influencer son âme, à semer l'athéisme et à préparer le terrain pour que, le moment venu, il signe une condamnation à mort. La conversation entre les deux montre comment la négation du spirituel (l'existence de Dieu, du diable, de l'âme) peut cacher le véritable drame intérieur de l'être humain.
Konzelman et Solomon parviennent à faire comprendre, avec une habileté remarquable, comment le psychiatre parvient à se sauver de la possession en retrouvant la foi et la confiance en Dieu. C'est précisément cette invocation qui empêche le démon de pénétrer en lui. Ainsi, le chemin du mal apparaît comme un processus : il commence par l'orgueil et l'égoïsme, passe par la méfiance à l'égard de Dieu et culmine dans son reniement ou dans l'adoration d'une fausse image, déformée par Satan lui-même.
Le film montre clairement et profondément que le rejet de Dieu conduit à une incapacité radicale à traiter le problème du mal, tant dans sa propre souffrance que dans celle des autres. Et lorsque Dieu est nié, le mal devient encore plus incompréhensible et désespéré. Il ne s'agit pas ici de résoudre le problème du mal, mais de l'exposer. Pour une réflexion plus large sur cette question, voir les travaux récents de José Antonio Ibáñez Langlois.
Le mystère de la souffrance et la liberté humaine
Il est important de distinguer deux types de mal : le mal physique et le mal moral. En ce qui concerne le premier, il suffit de se rappeler que la création est un système naturel en équilibre, où certains processus impliquent la douleur ou la destruction, mais ne sont pas dénués de sens. Dieu n'est pas l'auteur du mal, ni directement ni indirectement. Il a créé le monde avec ses lois naturelles et il est toujours présent pour nous aider à donner un sens transcendant à nos maux.
En ce qui concerne le mal moral - le péché - Dieu le permet parce qu'il a voulu avant tout que l'être humain soit libre, capable de choisir le bien et donc d'aimer. La liberté, comme l'a rappelé saint Jean-Paul II dans Splendeur de Veritatisest indissociable de la Vérité, qui est le Christ lui-même : "Voie, Vérité et Vie". C'est pourquoi saint Thomas conçoit la liberté comme une force, saint Josémaria comme une énergie et Edith Stein comme le courage de l'âme libre.
Une réponse chrétienne à la souffrance
Enfin, il convient de souligner l'exposé lucide de la souffrance offert par Saint Jean-Paul II dans Salvifici doloris. Face à la grande question qui s'est posée après l'horreur de l'Holocauste - "Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Benoît XVI Il a proposé de transformer la réflexion en prière : "Pourquoi, Seigneur, as-tu permis cela ? Et Jean-Paul II a donné une réponse chrétienne et pleine d'espoir : la souffrance peut devenir une vocation, une participation à la croix rédemptrice du Christ. Un mystère qui n'élimine pas la douleur, mais lui donne un sens éternel.
Évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Santo Domingo, République dominicaine