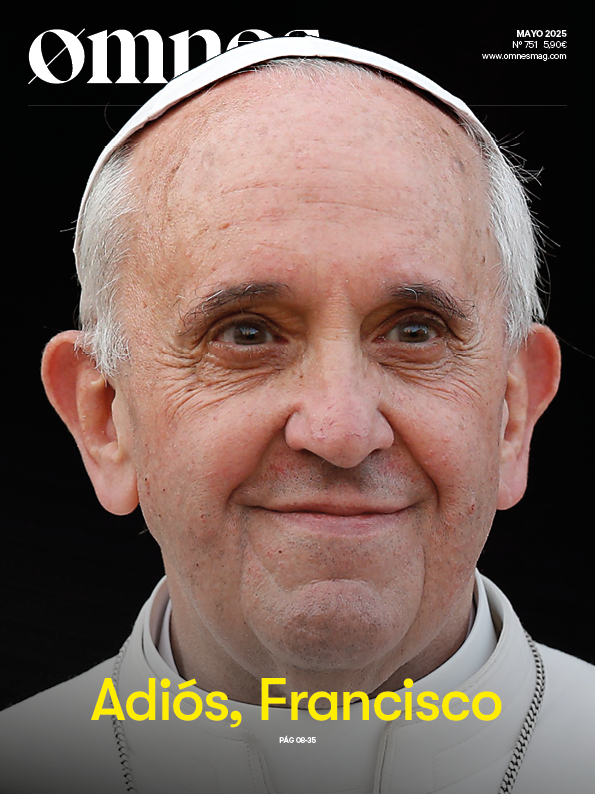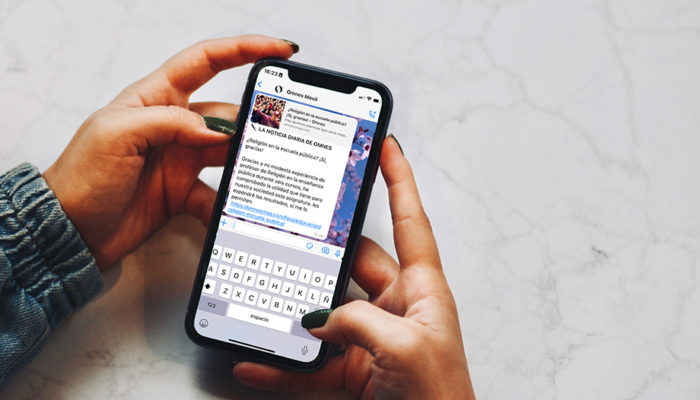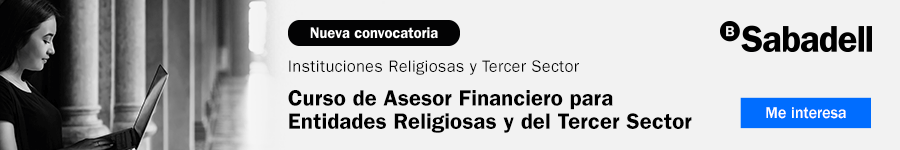La liberté religieuse n'est pas seulement une préoccupation pour les fidèles, c'est un droit humain fondamental qui renforce le tissu même de la société démocratique. À une époque de polarisation croissante, où les croyances et les idéologies s'affrontent souvent, la possibilité de pratiquer ou de rejeter librement la religion reste une pierre angulaire de la dignité humaine et de l'harmonie sociale.
Pour les croyants comme pour les non-croyants, la liberté de religion est profondément liée à d'autres droits essentiels, tels que la liberté d'expression et la liberté d'association. Ces droits n'existent pas de manière isolée, mais se renforcent mutuellement. Lorsque l'un d'entre eux est mis à mal, l'effet d'entraînement affaiblit le cadre plus large des libertés civiles. C'est pourquoi les mesures répressives prises par les gouvernements à l'encontre de l'expression religieuse, que ce soit par la censure, l'emprisonnement ou la violence, sont plus que de simples attaques contre la foi. Elles sont le signe d'une dangereuse érosion des droits de l'homme.
Alors que le monde moderne est aux prises avec des questions d'identité, de gouvernance et de coexistence, le rôle de la liberté religieuse doit rester au premier plan du discours culturel et politique. Elle n'est pas seulement un privilège pour les pieux, mais une condition nécessaire à la justice, à la paix et à la sécurité. paix et l'épanouissement humain.
Comment définir la liberté de religion ?
La liberté religieuse et ce qu'elle implique d'un point de vue juridique sont énoncés à la section 1, article 9 de la Convention européenne des droits de l'hommequi stipule que "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites".
Pour préciser cette définition, il faut comprendre que la liberté religieuse se compose de deux aspects fondamentaux : la "liberté de" et la "liberté de". Nous devons comprendre que la liberté de religion se compose de deux aspects fondamentaux, la "liberté de" et la "liberté de". La première fait référence au fait que les individus ne sont pas contraints de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion contre leurs convictions. Ni les gouvernements, ni les sociétés, ni les individus ne peuvent obliger les gens à agir contre leur conscience. Simultanément, la seconde se réfère à l'orientation positive des individus à rechercher et à agir en accord avec les vérités religieuses qu'ils suivent.
Les êtres humains étant des êtres sociaux et vivant en société, c'est le rôle de la société dans son ensemble et des gouvernements d'encourager la pratique de la religion. La liberté religieuse implique que les familles, les communautés et les institutions ont la liberté et la responsabilité d'aider les gens à mettre en œuvre leurs convictions religieuses.
Le devoir
Fondamentalement, la liberté implique des devoirs. La liberté d'expression implique le devoir de protéger la réputation de quelqu'un, la liberté d'initiative économique implique le devoir de contribuer économiquement au bien commun, de même que la liberté de pratiquer sa religion implique le devoir de préserver la liberté d'une autre personne de vénérer Dieu selon ses convictions les plus intimes.
L'exercice de la vraie religion doit toujours sauvegarder la dignité innée de la personne humaine et promouvoir le bien commun. Tel est le test de validité des pratiques religieuses : promeuvent-elles le respect de la dignité innée de chaque personne humaine ? En répondant à cette question, nous rationalisons moralement que des pratiques telles que l'infanticide, la polygamie, l'esclavage, les abus psychologiques, la guerre, les conversions forcées et autres ne peuvent pas faire partie du droit de pratiquer une religion, même si elles sont faites au nom de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils portent atteinte à notre dignité humaine intrinsèque et nuisent au bien commun.
Notre droit inhérent à la liberté de religion exige que la société s'abstienne d'interférer indûment avec les pratiques religieuses des gens et qu'elle établisse un environnement propice à une expression religieuse saine. Une société libre est une société dans laquelle les gens peuvent rechercher activement la vérité religieuse et la vivre en public et en privé. La liberté religieuse est un droit de l'homme universel, et non une revendication spéciale de privilège de la part d'une confession ou de la possession d'une foi par rapport à d'autres. Ceci étant dit, pourquoi la liberté religieuse devrait-elle avoir de l'importance dans notre société ?
La liberté religieuse promeut les valeurs familiales et la dignité humaine.
La liberté religieuse permet aux personnes de vivre de manière fructueuse la vénération qu'elles souhaitent accorder à Dieu. Le respect de Dieu implique le respect de chaque personne en tant qu'enfant de Dieu, qui reconnaît la dignité intrinsèque des personnes. Cette reconnaissance est la garantie et la base de tous les droits humains fondamentaux : le droit à la vie, à l'éducation, à l'initiative économique, etc.
Cette compréhension essentielle des droits et des responsabilités de chacun se développe généralement dès le plus jeune âge, principalement au sein de la famille. Comment ? Sous la tutelle de leurs parents, les enfants apprennent l'importance de promouvoir le bien de la famille au sein de leur propre famille ; ils apprennent la valeur de l'amour, du respect et de la fidélité. En même temps, ils apprennent que l'amour s'étend à d'autres personnes que leur famille ; cet amour social se manifeste en aidant ceux qui sont dans le besoin, en défendant les droits des opprimés et en promouvant l'accès aux droits universels.
La dignité naturelle de chaque être humain n'est pas un accommodement aléatoire fait par la société ou les gouvernements ; la dignité humaine est inhérente précisément parce qu'elle est innée et qu'elle fait partie intégrante de l'être humain. Cette compréhension de la valeur de chaque personne s'apprend avant tout dans une famille aimante et stable, qui transmet la conviction qu'il s'agit d'un don de Dieu, et non d'une quelconque institution humaine. La vraie religion le fait automatiquement, et l'influence qu'elle exerce sur les parents et les enfants forme une culture du respect, qui influence les valeurs de chaque personne dans une société, ce qui, à son tour, a un impact positif sur l'activité sociale, y compris la politique, qui, en fin de compte, contribue à façonner la société dans son ensemble.
La liberté religieuse favorise l'harmonie sociale
Dans une société laïque, il peut être facile de négliger ce que la religion apporte à la communauté, et pour les personnes non religieuses, il peut être difficile de comprendre pourquoi la foi est si importante pour les individus. La liberté de pratiquer sa religion comprend également la liberté des croyants de vivre leurs convictions dans les services et les actes de charité qu'ils fournissent à la communauté au sens large.
Les individus et les organisations motivés par leur foi et leurs profondes convictions religieuses s'occupent des laissés-pour-compte de la société, attirent l'attention sur les injustices sociales qui doivent être combattues et travaillent dans des situations dangereuses pour instaurer la paix. Par conséquent, à l'instar d'autres droits fondamentaux, la liberté de religion doit être au cœur des diverses sociétés démocratiques, et non en marge de celles-ci.
Lorsque les gens sont libres de pratiquer leur religion sans craindre d'être persécutés ou discriminés, ils peuvent exprimer pleinement leurs croyances et vivre en accord avec elles. Cela contribue à son tour à renforcer le sentiment d'estime de soi et de dignité.
En outre, la liberté religieuse favorise le respect d'autrui et la paix, car elle contribue au développement d'une société qui valorise les différences individuelles.
Lorsque des personnes ayant des croyances religieuses différentes travaillent ensemble pour le bien commun, c'est un signe positif que les difficultés et les différences peuvent être surmontées pour le bien de tous. Cette atmosphère de respect mutuel basée sur des croyances partagées contribue à promouvoir la cohésion sociale et la stabilité au sein d'une société en pleine croissance. À l'appui de cette affirmation, une étude indique que la liberté religieuse a des effets positifs sur la gouvernance démocratique et la liberté d'expression d'une nation, tout en réduisant la probabilité d'une guerre civile et d'un conflit armé.
La liberté religieuse favorise la croissance économique
La recherche suggère que la liberté religieuse peut être corrélée au développement économique. Par exemple, une étude publiée par l'Interdisciplinary Journal of Research on Religion a montré que les pays où la liberté religieuse est plus grande ont tendance à avoir un niveau de développement économique plus élevé. Les auteurs de l'étude estiment que la liberté religieuse peut créer un environnement propice à l'esprit d'entreprise et à la croissance commerciale, promouvoir la paix sociale et la stabilité commerciale, réduire la corruption de l'État, encourager la créativité et stimuler le progrès technologique.
D'autres études ont également établi une corrélation positive entre la liberté religieuse et le développement économique. Une étude publiée par le Massachusetts Institute of Technology en 2020 a examiné des données provenant de plus de 150 pays et a constaté qu'une augmentation de la liberté religieuse est associée à une plus grande probabilité qu'un individu prospère dans la société, ainsi qu'à un état de bien-être général plus élevé. Il a également noté que la suppression de la liberté religieuse entraverait l'esprit d'entreprise, l'innovation et le bien-être social.
Il convient toutefois de noter que la relation entre la liberté de religion et le développement économique est complexe et multiforme, et qu'elle dépend également du capital social d'un pays, des institutions gouvernementales et de nombreux autres facteurs qui peuvent également contribuer au développement économique.
Sauvegarde de la dignité
En bref, les droits de l'homme sont universels, car la dignité inhérente à la personne est une vérité humaine objective, fondée sur la morale et la philosophie, qui ne dépend pas de la race, de l'appartenance ethnique, de l'âge ou de la sexualité d'une personne. Ils permettent aux personnes de croire et de pratiquer la religion de leur choix, ou de ne pas avoir de religion du tout.
Dans l'ensemble, la liberté religieuse protège notre dignité inhérente et réaffirme la valeur présente dans le fait de vivre ses convictions en tant qu'être humain, son interdépendance avec les autres droits de l'homme consolide sa place dans une société démocratique prospère et, en même temps, elle a le potentiel d'être une source de paix intercommunautaire tout en offrant la possibilité d'augmenter la croissance économique, de réduire les conflits communautaires et de promouvoir le bien commun. En particulier, elle renforce la possibilité d'espoir et de paix dans un monde qui aspire avec optimisme à de telles valeurs.
Fondateur du "Catholicism Coffee".





 garantir la liberté de religion dans toutes ses manifestations et en tout lieu
garantir la liberté de religion dans toutes ses manifestations et en tout lieu